I. TRANSPORT DE CONTENEURS SUR LE RHIN ALLEMAND
L’une des grandeurs les plus intéressantes est le passage à la frontière germano-néerlandaise (Emmerich-Lobith).
On dispose de deux séries, d’une part une estimation en EVP, disponible depuis 1994, d’autre part une estimation en tonnes (transports de produits manufacturés) sur l’ensemble du bassin rhénan, disponible depuis 1987 ; elles ne se recouvrent pas totalement, mais évoluent dans le même sens.
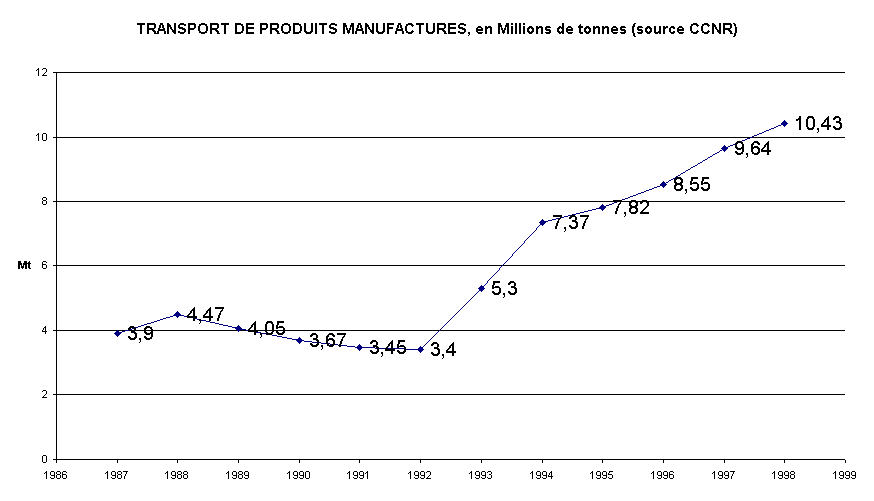
On observe dans la plus longue de ces séries (source Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, CCNR) une relative stagnation des tonnages de 1987 à 1992, suivie d’une forte croissance depuis. Si l’on transforme ces tonnages en EVP, avec un coefficient de 11,5t par EVP, comme observé en 1996, on constate avant 1993 des volumes d’EVP sensiblement plus élevés que ceux indiqués par les ports allemands. La raison de cette discordance n’est pas connue, et peut-être due à un changement de définition statistique. On ne retiendra donc les données antérieures à 1992 qu’à titre d’information.
Dans la seconde série, exprimée elle en EVP, on note une pause dans la croissance entre 1994 et 1995, suivie d’une croissance soutenue pour arriver aujourd’hui à 900.000 EVP à ce point de comptage.
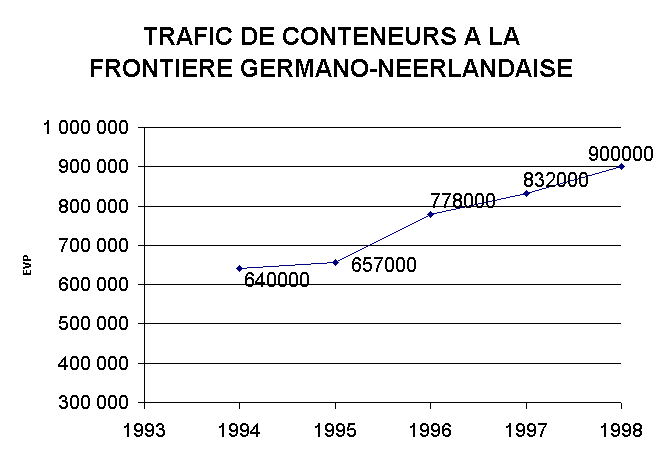
Il y a une autre grandeur disponible, celle du passage à la frontière franco-allemande, également fournie par la CCNR, qui constitue un sous-ensemble des valeurs précédentes. On ne possède cependant pas de séries très longues sur cet élément.
Enfin, depuis 1994, le Statistisches Bundesamt fournit le trafic national allemand, le trafic international et celui en transit. En 1998, le chiffre global devrait être voisin de 1.000.000 EVP. Cette valeur inclut des trafics qui ne touchent pas le Rhin, pour un montant d’un peu moins de 100.000 EVP en 1998.
Cette série est très semblable à celle fournie par le BÖB, l’Association des Ports publics allemands, laquelle exclut les trafics des terminaux privés, dont deux au moins sont régulièrement desservis au départ de Rotterdam et d’Anvers. On retiendra donc en première approximation le chiffre global des ports publics allemands comme représentatif du trafic rhénan, car il présente l’avantage de fournir une plus longue série chronologique. Cette approximation est confortée par les chiffres de 1996, pour lesquels on dispose des détails respectifs des deux séries. En y ajoutant Bâle et les ports français du Rhin, on obtient la série " Trafic Rhénan Nouveau ".
II. TRANSPORT DE CONTENEURS DANS LES BOUCHES DU RHIN
L’un des éléments les plus intéressants de l’évolution du transport de conteneurs en Europe a été le développement spectaculaire du transport de conteneurs dans les Bouches du Rhin, qu’il s’agisse de transport intérieur néerlandais ou de trafics échangés avec la Belgique et le Nord de la France.
Le transport intérieur néerlandais s’est développé contre toute attente, malgré la faible distance de transport, et le trafic d’échange entre Anvers et Rotterdam est devenu presque égal au trafic du Rhin.
Des statistiques précises existent, mais elles sont trop agrégées (EVP fluviales transbordées au port de Rotterdam, qui ont plus que triplé de 87 à 96). On devra donc faire des approximations.
On a ainsi reconstitué une série montrant la part du trafic d’Anvers échangé avec Rotterdam, d’une part, et qui échappe à la statistique rhénane, ainsi que d’autre part l’élément rhénan du trafic d’Anvers, qui ne doit pas être compté deux fois.
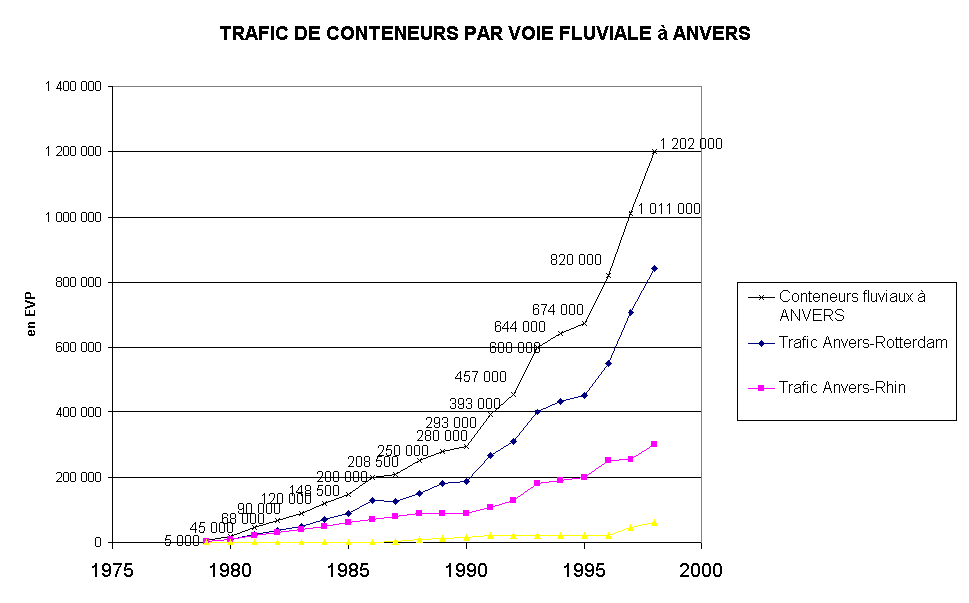
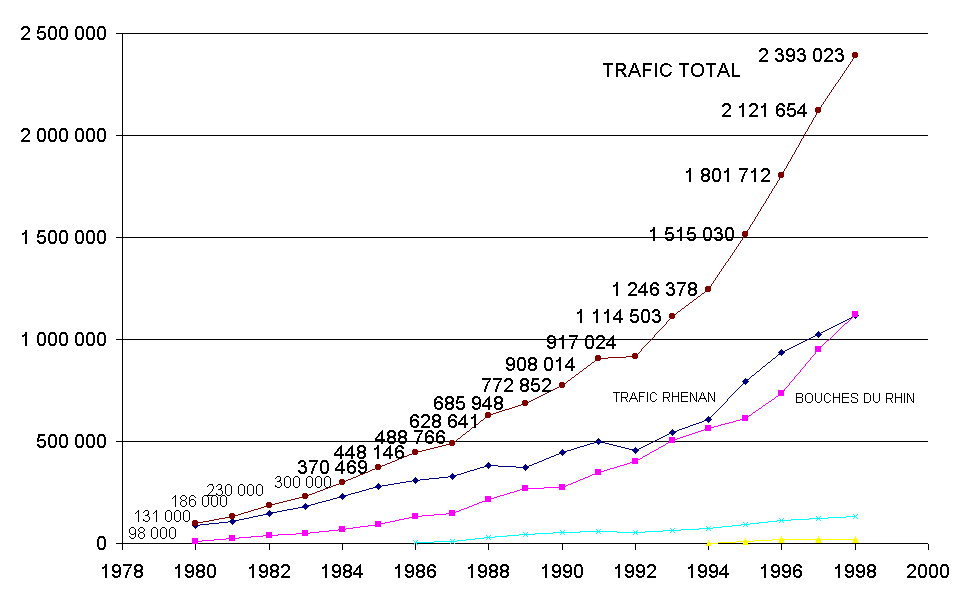 La courbe correspondante est peut-être encore plus parlante : Quand on connaît le marasme de l’économie européenne dans les années 90, qui peut encore douter de la capacité de la navigation fluviale à s’adapter aux aspects les plus novateurs de l’économie moderne ?
La courbe correspondante est peut-être encore plus parlante : Quand on connaît le marasme de l’économie européenne dans les années 90, qui peut encore douter de la capacité de la navigation fluviale à s’adapter aux aspects les plus novateurs de l’économie moderne ?